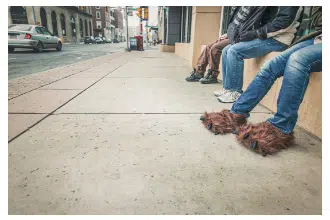32 % d’inscrits en plus en première année de santé en cinq ans, pour moins de 20 % d’admis au concours : la sélection n’a jamais été aussi féroce. Depuis la réforme de 2020, PASS et LAS se disputent la vedette, mais aucun parcours ne fait l’unanimité. Les professionnels en reconversion composent aujourd’hui un quart des nouveaux arrivants, souvent confrontés à des obstacles insoupçonnés au moment de l’inscription. Les critères de choix traditionnels ne suffisent plus pour s’orienter avec justesse.
Panorama des formations et métiers de la santé : comprendre un secteur en pleine évolution
Entrer dans l’univers de la santé, c’est se confronter à une diversité de parcours et de métiers en mouvement permanent. Le secteur de la santé offre un éventail de professions, du médical au paramédical, qui reflète l’évolution des besoins et des pratiques. Chaque branche impose ses propres attentes, ses codes, et une réalité du terrain qui ne laisse guère de place à l’improvisation.
Prenons MMOPK : sous cette appellation se glissent les études de médecine, maïeutique (sage-femme), odontologie (chirurgie dentaire), pharmacie et kinésithérapie. Ces filières sollicitent une endurance hors norme et une implication de tous les instants, tant la sélection et le niveau de technicité sont élevés.
Pour se repérer dans la mosaïque des possibles, quelques trajectoires parlent d’elles-mêmes :
- Le médecin peut choisir l’hôpital, le cabinet, un centre de santé ou s’orienter vers l’industrie pharmaceutique.
- Le pharmacien partage ses activités entre officine, recherche et industrie, voire missions de santé publique.
- La sage-femme exerce à l’hôpital, dans une PMI ou ouvre son propre cabinet.
Là où les études médicales exigent patience et ténacité, les métiers paramédicaux constituent d’autres passerelles. Infirmier, aide-soignant, ambulancier, orthoptiste ou manipulateur en électroradiologie… Ces professions nécessitent une solide formation en institut ou en école, mais sans la longueur décourageante des études médicales. Un infirmier a la latitude de travailler en hôpital, en libéral, dans une maison de retraite ou un centre. Même souplesse pour les aides-soignants et auxiliaires de puériculture, présents dans une foule d’établissements.
Douze années pour devenir médecin spécialiste, trois ans pour décrocher le diplôme d’infirmier, un an pour être aide-soignant : chaque parcours construit sa logique, sa temporalité. Les métiers se multiplient, les chemins de formation aussi. Cette arborescence permet à chacun d’adapter son projet professionnel aux besoins concrets du système de santé.
PASS, LAS ou autres parcours : quelles différences et pour qui ?
Depuis la réforme des études de santé, deux portes d’entrée dominent la première année : le PASS (parcours d’accès spécifique santé) et la L.AS (licence avec option santé). Comment s’y retrouver ?
Le PASS s’adresse d’abord aux détenteurs d’un bac général, plus particulièrement à ceux qui maîtrisent mathématiques, physique-chimie ou SVT. Ces matières préparent à des enseignements pointus et à une concurrence redoutable, où la biologie côtoie la chimie et les sciences humaines.
La L.AS propose une stratégie alternative : l’étudiant suit une licence « classique », droit, sciences, lettres, et ajoute une option santé. Cette solution convient à ceux qui souhaitent sécuriser leur parcours tout en gardant l’ambition d’intégrer les filières médicales ou paramédicales, à condition de réussir une sélection différente, généralement via le dossier scolaire et parfois des épreuves supplémentaires.
Tout se joue lors de l’inscription à l’université : analyse des notes, projet de formation, voire passage devant un jury. Les quotas d’admission varient selon les régions et pèsent sur le processus. Après la sélection, les années suivantes mêlent stages, externat, puis internat ou thèse selon la filière. Certaines universités offrent également des passerelles ou mettent en place des remises à niveau pour les adultes en reconversion ou les profils non scientifiques.
Une certitude : la quantité d’efforts demandés ne recule jamais. Motivation et régularité forment le socle de la réussite, quelle que soit la voie choisie.
Critères essentiels pour choisir son cursus médical selon son profil et ses objectifs
Avant de franchir le cap, mieux vaut vérifier ses fondamentaux. Trois ingrédients s’imposent avant d’aborder une formation médicale : rigueur, motivation et endurance. Selon les études, les attendus diffèrent, mais l’engagement à fournir ne laisse jamais place à la demi-mesure. Pour les parcours les plus longs, médecine, pharmacie, la capacité d’organisation et l’autonomie deviennent vite décisives.
Le bagage scientifique acquis au lycée (mathématiques, physique-chimie, SVT) fluidifie la transition vers la MMOPK et permet de comprendre rapidement les méthodes et raisonnements propres au secteur.
La cohérence du projet professionnel joue aussi un rôle-clé : médecin, pharmacien, sage-femme marchent souvent main dans la main avec de longues études et d’imposantes responsabilités ; le paramédical permet d’intégrer la vie active plus rapidement, après quelques mois à trois ans de formation.
Pour peser le pour et le contre, voici des paramètres concrets à considérer :
- Compétences relationnelles et savoir-être : goût pour le collectif, résistance au stress, sens aigu du soin.
- Projet de vie : disponibilité, mobilité, rythme de travail envisagé.
- Débouchés : hôpital, cabinet, industrie pharmaceutique, centre de santé, secteur privé ou médico-social.
Aligner ses contraintes, ses capacités et ses ambitions s’avère déterminant. Les IFSI (instituts de formation en soins infirmiers) accueillent les futurs infirmiers ; l’université guide les étudiants en médecine, pharmacie, dentaire ou maïeutique. À chacun de s’engager dans un cursus qui épousera véritablement ses qualités et ses attentes à long terme.
Réussir sa reconversion dans la santé : conseils pratiques pour franchir le cap
Reprendre sa carrière en main, retrouver du sens, miser sur un secteur qui ne connaît pas la crise : chaque année, la santé séduit une vague de candidats en reconversion. Les dispositifs n’ont jamais été aussi accessibles pour ceux qui souhaitent transformer l’essai et repartir sur des bases solides.
Tout commence souvent par un bilan de compétences. Ce passage obligé aide à cerner ses atouts, ses envies, mais aussi à pointer les formations ou métiers de la santé les plus adaptés au parcours antérieur.
Pour avancer concrètement, le recours à un conseiller en évolution professionnelle (CEP) donne des repères clairs : présentation des possibilités, choix d’organismes certifiés, élaboration d’un plan d’action réaliste. Dans bien des cas, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) constitue un tremplin : elle permet valoriser son vécu professionnel et d’accéder à une certification sans repartir de zéro.
Côté financement, plusieurs dispositifs jalonnent la route :
- Compte Personnel de Formation (CPF)
- Projet de Transition Professionnelle (PTP)
- Subventions accordées par certaines régions
- France Travail (ex-Pôle emploi)
Les salariés en réflexion peuvent, de leur côté, s’appuyer sur l’accompagnement de Transitions Pro. D’autant que la formation continue s’adapte : programme court pour les métiers d’ambulancier ou d’aide-soignant, formations plus longues pour devenir infirmier ou orthopédiste, selon l’expérience et les acquis.
Réorienter sa carrière vers le secteur santé demande méthode, implication et grande souplesse. Informez-vous sur les organismes, sur les perspectives concrètes d’embauche, et surtout, dialoguez avec ceux qui exercent déjà. Leurs retours, bruts et sans filtre, offriront souvent le déclic ou la prise de conscience indispensable.
Au final, choisir sa formation médicale ne relève jamais d’un simple pari. C’est une aventure où l’on avance, parfois à tâtons, mais avec, au bout, la possibilité de faire résonner son engagement au plus près de la vie des autres. À chacun d’ouvrir sa propre porte, avec détermination, exigence et cette irrépressible envie d’être utile.